Sommaire de la page
Editorial
Ce mois de juin est marqué par la « Semaine QVCT 2025 », organisée par l’Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), qui aura lieu la semaine du 16 au 20 juin.
Dans un monde du travail en constante évolution, marqué par des transitions écologiques, numériques et organisationnelles, la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) a un rôle important à jouer, notamment pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
La QVCT ne se résume pas à un « mieux-être » au bureau. Elle questionne la manière dont le travail est organisé, reconnu, évalué et articulé avec la vie personnelle. Elle implique aussi tous les acteurs de l’entreprise : direction, encadrement, représentants du personnel, médecin du travail, services de prévention et de santé au travail, CARSAT et travailleurs.
Pour évoquer ces questions, dresser un bilan de la qualité de vie au travail, et tracer des perspectives, nous avons mené un entretien avec Catherine Fuentès, juriste en droit social à l’Institut du travail et formatrice auprès des CSE. Vous trouverez un compte- rendu de cet entretien dans cette nouvelle lettre d’information.
Pour mieux comprendre le dialogue social autour de la QVCT, nous vous proposons également 2 tableaux synthétiques présentant des accords signés sur ce thème et disponibles sur le site dialogue-social.fr.
Bonne lecture !
La qualité de vie au travail : quel bilan, quelles perspectives ?
La qualité de vie au travail est née d’une volonté partagée des partenaires sociaux, et elle s’est progressivement imposée comme un levier important pour allier bien-être des salariés et performance des entreprises. Aujourd’hui, cette notion ne se limite plus à des initiatives ponctuelles ou à une simple tendance managériale : elle est devenue un enjeu majeur du dialogue social. Elle englobe des aspects essentiels tels que le travail, l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, la reconnaissance et le sens du travail, l’autonomie, la santé mentale et physique des travailleurs.
Pourtant, une étude récente révèle que moins de la moitié des salariés (48%) estiment que leur employeur prend en compte la question de la qualité de vie au travail, alors même que cette question est considérée comme prioritaire par 88% des personnes interrogées.
Pour évoquer ce paradoxe, et plus largement pour parler des différentes dimensions et enjeux de la qualité de vie au travail, nous avons souhaité interroger Catherine Fuentès, maitre de conférence associée à l’institut du travail de Strasbourg et formatrice des membres élus du CSE.
;els progrès ont été réalisés ? Comment inciter à mieux prendre en compte la protection de la santé des salariés et notamment la santé mentale ? Pourquoi est-il nécessaire de centrer la réflexion sur le travail, ses conditions d’exercice, son organisation, sur le sens donné au travail ? ;e dire des démarches QVCT qui se résument à des actions de « bien-être » sans s’intéresser au travail ? Telles sont les grandes questions évoquées au cours de cet entretien.
Qualité de vie au travail (QVT), Qualité de vie au travail et conditions de travail (QVCT) …de quoi parle-t- on ?
Catherine Fuentès rappelle que la notion de QVT a émergé dans les années 70-80 : « Au départ, le concept visait la conciliation de la satisfaction des travailleurs et la productivité de l’entreprise », précise-t-elle. Puis, l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 1s juin 2013 « Vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle » est venu la définir. La QVT se définit comme : « un sentiment du bien-être au travail perçu collectivement et individuellement et qui consiste à faire un travail de qualité dans des bonnes conditions ». La notion de ;alité de Vie au Travail (QVT) a ensuite été introduite dans le Code du travail français en 2015, avec la loi Rebsamen du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l’emploi. Cette loi a inscrit la QVT comme un thème obligatoire de la négociation annuelle obligatoire (NAO) dans les entreprises de 50 salariés et plus, au même titre que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’ANI du 9 décembre 2020 marque une étape importante, avec le remplacement de la notion de QVT par celle de QVTC, et c’est la loi du 2 août 2021, dite Loi Santé, qui l’introduit dans le code du travail.
Cette loi, entrée en vigueur le 31 mars 2022, suggère certes aux partenaires sociaux d’aborder un nouveau sujet dans les négociations obligatoires : la santé et la sécurité au travail ainsi que la prévention des risques professionnels. Mais c’est une simple faculté même en cas d’application des dispositions supplétives. « La négociation peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels ».
On peut regretter que ce soit une simple faculté, au même titre qu’il est dommage que les questions autour du sens, de la qualité au travail et du pouvoir d’agir des salariés évoqués dans l’ANI de 2020 n’ont pas été transposées dans cette loi du 2 août 2021.
Pour aller plus loin, Catherine Fuentès invite le lecteur à consulter en ligne sur le site de l’ANACT le nouveau référentiel QVCT qui complète la rosace existante2. On y découvre les s thèmes de la QVCT identifiés :
- Organisation, contenu et réalisation du travail
- Compétences et parcours professionnels
- Égalité au travail
- Projet d’entreprise et management
- Dialogue social et professionnel
- Santé au travail et prévention
Ces thèmes sont bien sûr tous en lien direct avec la prévention des risques psycho-sociaux.
A l’origine, les partenaires sociaux parlent de « bien-être au travail ». ;’est-ce que cette notion de bien-être au travail ?
Pour Catherine Fuentès, il faut bien faire attention à cette notion qui se rapproche plus de la santé au travail que du bien-être au sens commun. Elle renvoie au préambule de la constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui associe spécifiquement la notion du bien-être à celle de santé3. Plus précisément, le texte dispose que « la santé correspond à un état complet de bien-être physique, mental et social et non pas seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité ». La notion du bien-être apparaît aussi dans la définition que l’OMS donne de la santé mentale. Celle-ci correspond « à état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté ». En combinant ces deux définitions, Catherine Fuentès propose sa vision du bien-être tel que visé par la qualité de vie au travail, « qui ne consiste pas seulement à une absence de la maladie mais renvoie à une notion d’hygiène mentale fondée sur les relations harmonieuses entre les personnes ». Elle précise « que ces dernières ne peuvent exister que si on centre l’analyse sur le travail et les conditions de travail ».
Pourquoi parle-t-on depuis 2020 de QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail)?
Pour Catherine Fuentès, ce changement marque « le basculement d’une démarche individuelle vers une démarche collective qui incite à s’interroger sur le travail et sur les conditions de travail ».
Les analyses réalisées par l’ANACT au fil des ans ont révélé que, dans les accords QVT, le thème de la santé au travail était assez peu présent, notamment dans son aspect de charge de travail. « Certes, on va avoir des mesures phares, comme par exemple l’interdiction des réunions après 17h, mais on trouve très peu de choses en amont sur les conditions de travail, sur la charge et l’organisation du travail, qui pourtant sont primordiales si on veut privilégier la qualité de vie et les conditions de travail ».
C’est pour contrer cela que les partenaires sociaux, puis le législateur, ont complété cette notion de QVT.
Pour Catherine Fuentès, ce changement est positif : « Parler uniquement de qualité de vie au travail pourrait se résumer à l’adoption de mesures qui ne sont pas forcément en lien avec le travail, mais qui relèvent du pur bien-être, tels que des ateliers bien-être, massage, sport, décoration des bureaux, etc. Certes, ces mesures sont bonnes, mais ce ne sont pas celles qui sont attendues dans le cadre d’un accord QVCT qui veut vraiment promouvoir la santé au travail, comme le suggérait l’ANI de s décembre 2020 ».
La démarche QVCT « ne peut plus se résumer à des mesures « vitrine », qui se résument à des actions de bien-être sans s’intéresser au travail ». « S’en tenir exclusivement à ce type de mesure serait dangereux pour la protection de la santé des salariés et inefficace en termes d’amélioration des conditions de travail ». En effet, elle rappelle qu’il est important et indispensable d’agir sur les causes plutôt que sur les conséquences. « Par exemple, acheter un coussin massant permet d’adoucir les conséquences, à savoir les douleurs cervicales, plutôt que d’agir sur l’organisation du travail, l’aménagement du poste… »
Pourquoi le législateur a-t-il décidé d’associer les notions de QVTC et d’égalité? ;el est le lien entre ces deux notions ?
« Ce n’est évidemment pas anodin d’associer ces deux négociations », admet Catherine Fuentès. Cette association vise à intégrer les enjeux d'égalité dans la gestion quotidienne des conditions de travail. Néanmoins, elle aimerait aller plus loin. Pour elle, la QVCT devrait être un élément transversal de toutes négociations. « Ce n’est pas qu’en matière d’égalité professionnelle qu’on devait parler de QVCT » souligne- t-elle. Cela d’autant plus que « la loi du 2 août 2021 est venue intégrer la QVCT dans les dispositions supplétives du Code du travail ».
L’introduction récente de la prise en compte dans l’évaluation des risques de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe (loi 2 août 2021 en vigueur depuis le 31 mars 2022, article L.4121- 3 du Code du travail) démontre bien la nécessité de raisonner en termes de santé au travail et de prévention des risques.
Quel est le rôle du CSE en matière de QVTC ? ;els sont leurs leviers d’action ?
Pour répondre, Catherine Fuentès pose tout d’abord le principe : «quandonveutraisonnerQVCT,ilfaut raisonnersantéautravailetpréventiondesrisquesprofessionnels».Selon elle, «c’estlaseulefaçonde prendre en compte les problématiques liées aux conditions de travail, à la charge mentale et physique de travail, à la promotion d’un travail de qualité avec des moyens en adéquation ».
En ce sens, elle constate un avancement effectué par la loi du 2 août 2021 qui s’oriente sur la prévention et l’évaluation des risques professionnels, en accentuant notamment les obligations des entreprises en matière de consultation du CSE sur le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Concrètement, le CSE doit donner son avis sur l’évaluation des risques professionnels faite par l’employeur, et les moyens mis à disposition des salariés par l’employeur pour les prévenir.
A contrario, elle se montre très dubitative sur l’efficacité de cette consultation lorsqu’elle est faite « à la marge ». « Si l’on s’en tient exclusivement au DUERP et à une seule consultation sur l’ensemble du document, cette consultation ne renforce en rien la prévention des risques professionnels », souligne-elle. Pour elle, il est nécessaire d’associer à cette consultation en plusieurs étapes, celle sur le rapport de bilan sur l’hygiène, la sécurité et conditions de travail pour l’année N-1, et aussi sur le programme annuel de prévention et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) : « Si on raisonne avec ses trois documents, les CSE, les directions, les partenaires comme la CARSAT et les services de prévention et de santé au travail seront amenés à travailler ensemble sur ces thématiques et de faire un suivi ».
Enfin, il sera important de former les élus et de sensibiliser les salariés sur les démarches d’amélioration permettant de traiter très concrètement par exemple de la charge de travail. « L’outil méthodologique de l’ANACT « les essentiels de la QVT » est un levier à privilégier à mon sens4. La rubrique -Contenu du travail- me semble très adaptée ».
Quelles sont les bonnes pratiques en matière de QVCT ? Inversement, est-ce qu’il y a des mauvaises pratiques ?
Il n’y a pas des bonnes pratiques clé en main ! Par contre, Catherine Fuentès, forte de son expérience de terrain, souligne l’importance du diagnostic. Ce dernier se résume « à un engagement volontaire et une implication durable des directions des entreprises dans la mise en place des espaces de discussion, avec une organisation en amont des entretiens individuels ou collectifs des salariés sur le travail et sur la façon dont celui-ci se fait, pour identifier les facteurs qui le soutiennent, ou inversement, ceux qui l’entravent ». De son côté, le salarié sera alors plus à même à suivre une telle démarche volontaire et durable, « avec bien-sûrun suivi par le CSE et une réflexion par unité de travail, par service, sur la façon, les contraintes et les facteurs améliorant les conditions de travail ».
C’est ce diagnostic qui influe, par la suite, sur les bonnes pratiques à adopter pour chaque thème porté par la QVCT. Elle insiste, notamment, sur l’importance des thèmes de santé au travail, et d’organisation, contenu et réalisation du travail. De par sa pratique, elle constate que, dans le domaine de l’organisation du travail, par exemple, « ce sont les entreprises qui adoptent une démarche qualitative, portant sur le contenu du travail, les objectifs assignés et les moyens donnés aux salariés pour les atteindre, qui réussissent la QVCT ».
La nécessité d’un vrai dialogue en la matière est aussi mise en exergue tant par le juge 5que par le législateur : « Aujourd’hui, ilressort qu’onne peut pasfaire dela QVCT si onneraisonne pasentermes de dialogue, tant professionnel que social », insiste-t-elle. L’enjeu sera ensuite de garantir la pluridisciplinarité dans le cadre de ce dialogue : « Il faut faire intervenir des acteurs traditionnels que sont la direction, les élus, les salariés, mais aussi d’autres acteurs institutionnels, comme par exemple les services de prévention et de santé au travail, la CARSAT, et également d’autres disciplines telles que l’ergonomie, la psychodynamique du travail ». C’est la seule façon de garantir la construction d’un « vrai diagnostic, qui amènera à des mesures qui sont essentielles pour la QVCT ».
S’agissant des mauvaises pratiques en matière de QVCT, Catherine Fuentès met l’accent sur la prévention des risques psychosociaux (RPS) et la façon dont les entreprises les abordent dans le cadre de la QVCT :
« Quand les entreprises constatent que les mesures prises dans le cadre de la prévention des RPSne sont pas suffisantes, elles vont trop souvent s’intéresser uniquement au comportement du salarié et à la démarche individuelle, et non pas au collectif et l’environnement de travail dans sa globalité ». Or, cette pratique est contraire tant aux principes généraux de prévention du code du travail (4° de L.4122-2 du Code du travail), qu’à la définition même des RPS. En effet, les risques psychosociaux ce sont les éléments des conditions et de l’organisation du travail susceptibles d’interférer avec le fonctionnement psychique et de porter atteinte à la santé physique et psychique des salariés (définition rapport Gollac) et non comme le disait Xavier Bertrand « lorsque le salarié n’arrive pas à s’adapter sur l’organisation du travail ».
Quels sont les enjeux actuels entourant la QVCT ?
Pour Catherine Fuentès, l’enjeu essentiel actuel consiste à une réflexion et une analyse profonde sur la façon dont l’organisation et des conditions du travail peuvent être améliorées, pour qu’elles soient un facteur de l’attractivité de l’entreprise : «Aujourd’hui, les entreprises souhaitentêtreattractives, mais adoptent des mesures périphériques, de toilettage qui n’ont rien à voir avec une amélioration des conditions du travail », déplore-t-elle.
Pour conclure, elle insiste à nouveau sur l’importance « de sortir de l’impasse d’une démarche individuelle et interpersonnelle pour aborder collectivement ces questions ». « Il faut privilégier la recherche de solutions organisationnelles, seules garantes d’une démarche de prévention efficace et durable ».
Deux exemples d'accords de la qualité de vie au travail, des conditions de travail
Gardner Denver France poursuit sa démarche sur la qualité de vie au travail
Dans un but de renforcer leurs engagements en matière d’égalité professionnelle et de qualité de vie au travail, les partenaires sociaux de Gardner Denver France (la direction et l’organisation syndicale CFDT) concluent, le 02 avril 2024, un accord collectif triennal en la matière. Dans le domaine de la qualité de vie au travail, l’accord met un accent particulier sur l’harmonisation maximale de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
Le tableau, ci-après, synthétise les principales mesures adoptées en matière de qualité de vie au travail :
Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et a la qualité de vie au travail | |
Organisation du travail |
-Les réunions se dérouleront dans la limite du possible dans les plages horaires de 9h à 12h et 14h à 17h. Elles pourront se tenir en dehors de ces plages et les participants auront le choix d’y assister ou non sans aucune conséquence sur le déroulement de leur carrière ; -Définition à l’avance des plannings, lieux et dates des réunions.
-Rappel de l’existence d’un accord au sein de l’entreprise portant sur le droit à la déconnexion et d’une charte de télétravail ; -Temps partiel choisi : possibilité de formuler une demande de travail à temps partiel, dans les conditions prévues l’accord national du 7 mai 1996 sur l’aménagement de la durée du travail. L’entreprise porte une attention particulière à ce que ce temps partiel ne constitue pas une source de discrimination en matière de rémunération, de promotion et de développement de carrière.
-Leur organisation tient compte au maximum les contraintes personnelles des salariés ; -Un délai de prévenance est respecté dans la mesure du possible, au moins égal à la durée du déplacement envisagé ; -Les départs en déplacement le weekend devront être évités.
-Mise en place par le manager d’un entretien de reprise de poste afin de mettre à jour le salarié absent sur les changements organisationnels intervenus lors de son absence, aider le salarié à reprendre son poste, convenir des formations nécessaires à la réadaptation au poste, etc. |
Conditions du travail |
-Bilan de formations annuel réalisé par le manager et définition à partir de ce bilan, des formations nécessaires au développement des compétences de son équipe ; -Identification des souhaits d’évolution ou de formation du salarié, ou plus généralement, des questions/réflexions sur son travail lors de l’entretien annuel d’évaluation, ou même des points d’échanges réguliers avec le manager ; -Les salariés de plus de 45 ans ou qui totalisent entre 15 et 20 ans d’expérience professionnelle au sein de l’entreprise, et ceux travaillant à temps partiel, peuvent faire un point sur leur parcours et leurs perspectives professionnels au sein de l’entreprise lors de l’entretien professionnel.
-Formations spécifiques destinées aux managers relatives à la gestion des équipes, au management à distance, à l'accompagnement au changement ; -Sensibilisation des managers aux enjeux de la qualité de vie au travail.
-Aménagement des locaux de la salle de pause ; organisation d’événements favorisée (pots de départ, barbecue Noël, déjeuners dans l’espace extérieur de l’entreprise, etc.).
-Echanges avec les salariés volontaires à proposer des actions en la matière ; mise en place des actions telles que la journée de la Terre avec la « green team » de l’entreprise. |
Parentalité |
-Congé maternité : maintien de la subrogation du salaire dans la limite du plafond moyen de la sécurité sociale (PMSS), prise en charge de la 17ème semaine pour les salariés non-cadres (en autorisation d’absence payée par l’employeur) ;
-Affectation temporaire dans un autre emploi si l’état de santé l’exige (sous présentation d’un certificat médical), ne pouvant pas excéder la durée de la grossesse ; -Autorisations d’absence pour se rendre aux examens médicaux nécessaires, applicables aussi au conjoint de la femme enceinte. |
Suivi de l’accord | Suivi annuel assuré par la direction et les représentants du personnel, avec présentation par l’entreprise au CSE des indicateurs permettant de connaitre et d’apprécier la situation de l’entreprise, la réussite et l’évolution des objectifs et des actions fixés par l’accord. |
Lien de consultation de l’accord : https://www.dialogue-social.fr/articles-par-themes/article/gardner-denver-france-poursuit-sa-demarche-sur-la-qualite-de-vie-au-travail
TF1 s’engage dans une démarche durable et un dialogue permanent dans le domaine de la qualité de vie au travail
Fort d’une politique proactive dans le domaine de la qualité de vie et de conditions de travail et d’égalité professionnelle, le groupe TF1 renouvelle et renforce ses engagements en la matière. Ainsi, la direction et les organisations syndicales CFDT, CFTC et FO concluent, le 10 juillet 2024, un accord triennal en faveur de la qualité de vie au travail, des conditions de travail et de l’égalité professionnelle. Dans le domaine de la qualité de vie au travail, les parties expriment la conviction « que la performance durable du groupe passe par la conciliation entre la recherche de performance et l'attention portée à ses collaborateurs ».
Le tableau, ci-après, synthétise les principales mesures adoptées en matière de qualité de vie au travail :
Accord collectif en faveur de la qualité de vie au travail, des conditions de travail et de l’égalité professionnelle du groupe TF1 | |
Conditions de travail |
-budget dédié à chaque service pour l’organisation d’événements tels que la réussite d'un projet, une remise de médaille de travail, un départ à la retraite, un repas de fin d'année, etc.
-actions mobilité interne : conseils personnalisés par la coach Carrière & Mobilité du groupe ; ateliers carrière proposés tout au long de l'année ; possibilité d’immersion dans un autre service de TF1 via le dispositif de « Vis ma vie », et autres ;
-projets réguliers d'aménagement des espaces de travail, associant l’ensemble des acteurs (représentants du service de santé au travail, représentants de la mission handicap, représentants du personnel notamment) pour assurer notamment une conformité avec les règles de santé au travail.
|
Santé et sécurité |
-adhésion à un service de prévention et de santé au travail interentreprises accueillant tous les jours ouvrés les salariés souhaitant échanger avec le médecin sur leur situation personnelle ; -campagnes d'information régulières sur les régimes de prévoyance et santé offerts aux salariés par le groupe : téléconsultation médicale disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; réseau en optique, chirurgie réfractive, audioprothèses et soins dentaires ; Ostéopathe ; Conseils bien-être ; Soutien psychologique, etc. ; -abonnement à une salle de sport à proximité du site de TF1 à des tarifs préférentiels ; -suivis renforcés : contrôle de suivi du temps de travail pour les salariés au forfait-jours (identique à celui mis en place pour les journalistes) ; suivi individuel renforcé par le médecin du travail pour les salariés en horaires postés ou ceux travaillant en cycle ; -suivi des arrêts maladie : communication chaque année à la commission de suivi de l’accord des données relatives aux arrêts de travail et réalisation d’une étude sur l'absentéisme présentée à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ; -évaluation régulière par la direction de la QVT des salariés via des sondages anonymes ; -module de formation e-learning dédié à la sensibilisation à la prévention des RPS proposé par l'Université TF1 ; -violences au travail : possibilité pour toute victime ou témoin d'une situation inappropriée de de la signaler auprès de : la ligne managériale, le RRH, les préventeurs santé et sécurité, les instances représentatives du personnel, dont la CSSCT et/ou le réfèrent CSE en matière de harcèlement et violences au travail pouvant exercer une alerte auprès de la Direction, l'assistante sociale, le/la référent.e entreprise en matière de violence au travail et harcèlements ;
-aménagement des horaires de travail pour l'accompagnement d’un proche en situation de handicap ; -mise en œuvre de la plateforme « Care Manager » pour accompagner l’aidant familial dans leur rôle; -élargissement des « compteurs jours enfants malades » (5 jours d’absences autorisées par an) aux ascendants directs malades et/ou conjoint hospitalisés. L’âge en cas d'hospitalisation pour chaque période de référence. L'âge maximal de l'enfant en cas d'hospitalisation permettant d'utiliser le « compteur jours enfant malades » est aussi élargie à 16 ans ; -mise en place d'un régime complémentaire d'indemnisation du congé de solidarité familiale, cofinancé entre l'entreprise et le salarié à parts égales, permettant d’assurer un revenu de remplacement complémentaire à l'allocation journalière versée par la Caisse des Affaires Familiales ; -maintien des congés spécifiques pour parents d'enfants handicapés tels que prévus dans l'accord collectif en vigueur dans le groupe relatif au maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap (5 jours maximum par an) ; - check up santé pour tous les collaborateurs âgés de 55 ans et plus, et les salariés effectués sur leur temps de travail à hauteur d'une journée d'absence autorisée tous les 3 ans.
-actions de sensibilisation et d'information : formations dédiées à la gestion des maladies e proposée aux équipes, e-learning dédié au handicap ; -aménagements organisationnels et temporaires : aménagement du poste pour les salariés pouvant poursuivre leur activité professionnelle ; réduction de la durée du travail de 10 heures par semaine sans impact sur la rémunération pour les salariés touchés par une maladie invalidante les amenant à réaliser une démarche de RQTH ; possibilité de télétravail à temps partiel ou à temps plein pour les salariés atteints d'un cancer, d'une maladie invalidante ou d'un handicap -congé rémunéré pouvant aller jusqu'à 2 jours par mois pour les salariés atteints d'un cancer et qui maintiennent leur activité professionnelle, posés au plus proche du jour du traitement ; -12 jours de congés supplémentaires par an pour les salariées atteintes d’endométriose titulaires d’une RQTH ou étant engagées dans la démarche |
Parentalité |
-congé de paternité : maintien de salaire à 100% lors de la prise de ce congé ; -adoption : congé non rémunéré de six semaines (s’ajoutant au congé légal d'adoption) pour les salariés engagés dans une démarche d’adoption auprès d’un organisme reconnu dans un pays étranger ou une DOM-COM.
-les femmes enceintes bénéficient des autorisations d’absence rémunérées pour se rendre à 8 examens médicaux obligatoires. Le salarié en couple avec une femme enceinte bénéficie des autorisations d'absence rémunérées, pour l'accompagner à 3 de ses examens médicaux obligatoires ; -les salariées ayant recours à l’assistance médicale à la procréation bénéficient d’autorisation d’absence pour se rendre aux actes médicaux nécessaires.
-à partir du 4ème mois de grossesse : possibilité de bénéficier du télétravail régulier, à temps partiel ou à temps plein ; - à partir du 6ème mois de grossesse, et jusqu'à la fin du 5ème mois suivant l'accouchement : possibilité de bénéficier d'une réduction de la durée hebdomadaire du travail à hauteur de dix heures.
-Garde des enfants : allocation de 10€ nets par jour de garde d’enfant (pendant les jours travaillés du salarié), versée jusqu'à ses 3 ans ou son entrée en maternelle. Elle bénéficie aux salariés en CDI ou ceux qui se trouvent dans l'impossibilité d'exercer momentanément leur activité professionnelle (hospitalisation, maladie, congé maternité) ; versement des chèques emploi service universels de 50 € par mois (le 60 % -soit 30€- pris en charge par TF1) à compter de l’entrée en maternelle et jusqu’aux six ans révolus ou l’entrée en école primaire ; -réservation de 35 berceaux dans un réseau de crèches interentreprises. |
Articulation des vies | -mise à disposition des services de proximité (pressing, salon de coiffure, ou encore services à tarifs négociés pour les adhérents au régime frais de santé, tels que travaux ménagers, petits travaux de jardinage, courses à domicile, etc.) ; -mobilités : prise en charge d’au moins 50 % du prix des transports en commun, mise en place du forfait mobilités durables, prises de recharge pour les salaries disposant des véhicules électriques en contrepartie d’un abonnement mensuel modique ; –mise en place sur site des permanences avec les représentants des organismes d'assurance frais médicaux, un opticien, de l'action logement et de l'assistante sociale ; -déconnexion hors temps de travail : respect par les managers et les salariés d’une plage de déconnexion quotidienne de 20h30 à 7h30 (pour les collaborateurs qui ne sont pas postés ou planifiés) ; mentions spécifiques pour les mails reçus en dehors des horaires de travail. |
Suivi de l’accord | Suivi annuel par une commission de suivi composée de la direction et 2 membres par organisations syndicales signataires. |
Lien de consultation de l’accord : https://www.dialogue-social.fr/articles-par-themes/article/tf1-sengage-dans-une-demarche-durable-et-un-dialogue-permanent-dans-le-domaine-de-la-qualite-de-vie-au- travail
Sélection bibliographique
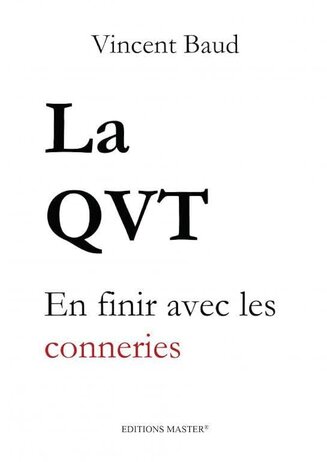
Vincent Baud, La QVT : en finir avec les conneries, 2022.
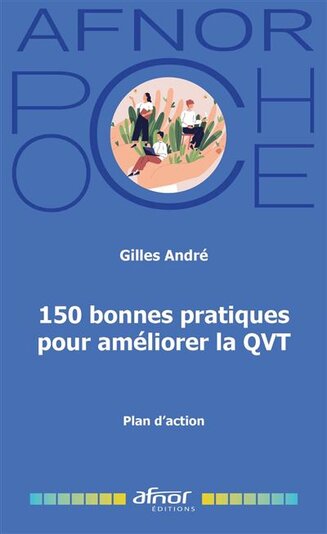
André Gilles, 150 bonnes pratiques pour améliorer la QVT : plan d’action, 2024.
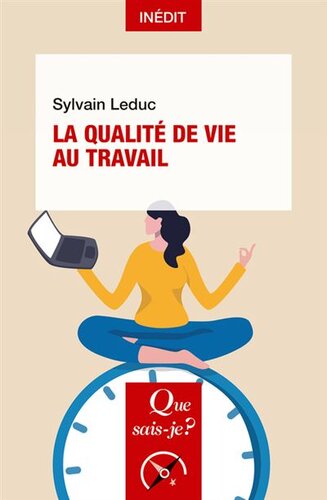
Sylvain Leduc, La qualité de vie au travail, 2025.

La (nouvelle) qualité de vie au travail : comprendre les enjeux et relever les défis dans votre entreprise, 2024.
Evènements à venir
L’Institut du travail de l’Université de Strasbourg vous invite à une série de webinaires sur les grandes thématiques du travail et du dialogue social (Contact et information : tiphaine.garat[at]unistra.fr / 03 68 85 83 25).
À vos agendas !
Webinaire : Un siècle de lutte contre la souffrance au travail Intervenant :RémyPonge-MCF,sociologue, Institut Régional du Travail de Marseille, Université Aix-Marseille | 24 juin 2025, 11h – 12h En ligne | https://applications.unistra.fr/invitation/inscription.php?inscription=ouictime=21032025111145 |
Webinaire : L’éco-anxiété Intervenant :JeanLeGoff, psychosociologue attaché au Centre Esta à Paris et docteur en sociologie. | 30 juin 2025, 11h – 12h En ligne | https://applications.unistra.fr/invitation/inscription.php?inscription=ouictime=1s0520 |
Webinaire: Impact de l'intensification et de l'autonomie au travail sur la santé mentale Intervenante : Sylvie Blasco – Professeur, économiste, Université Caen Normandie | 8 juillet 2025, 11h – 12h En ligne | https://applications.unistra.fr/invitation/inscription.php?inscription=ouictime=050s20 |
Pour se désabonner des informations dialogue social : https://www.dialogue-social.fr/lettre-dinformation/se-desabonner-de-la-lettre-dinformation