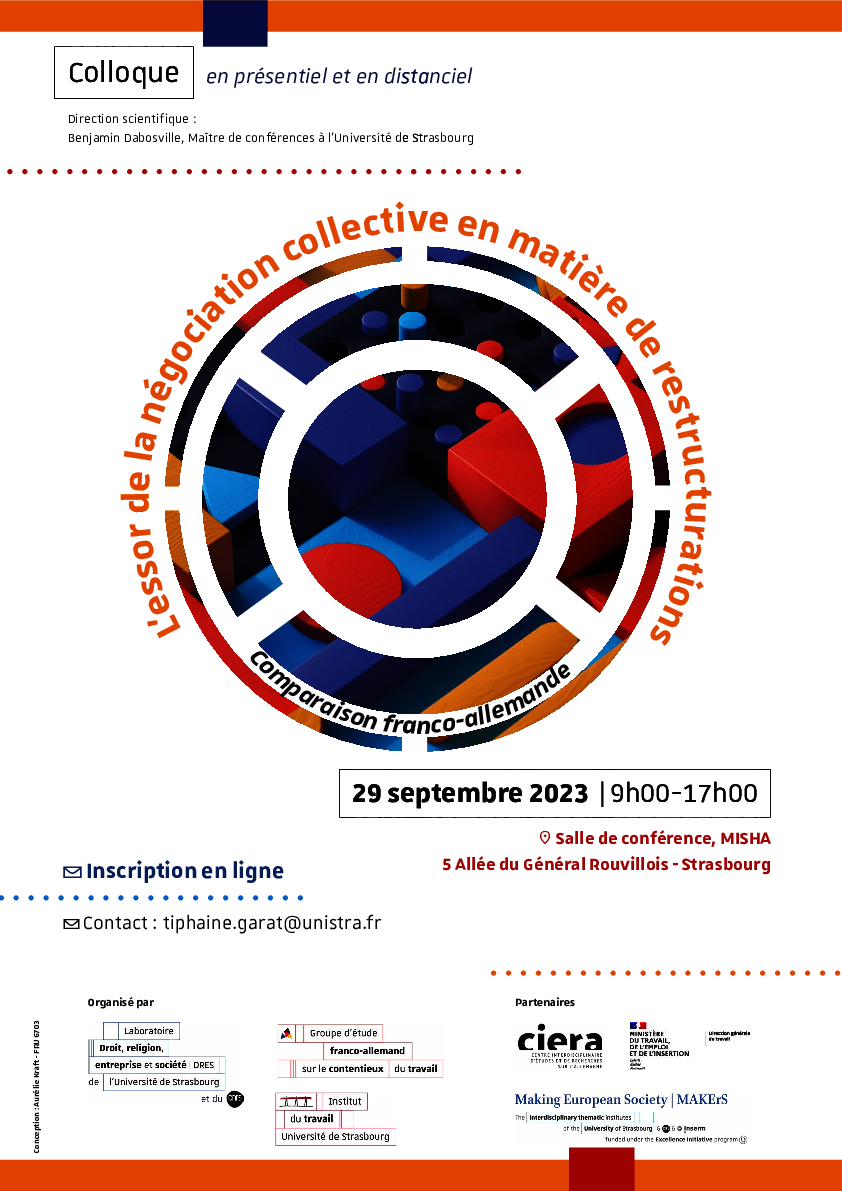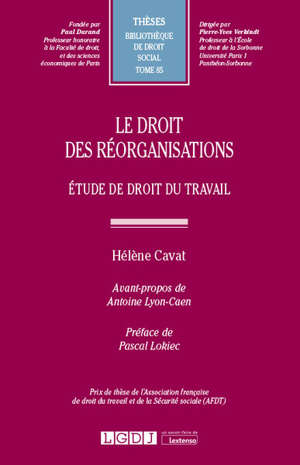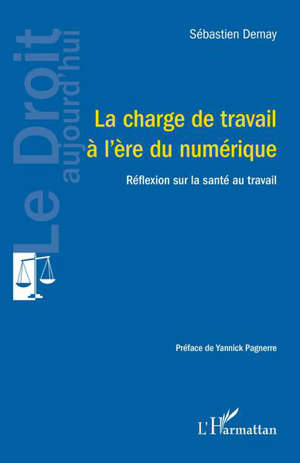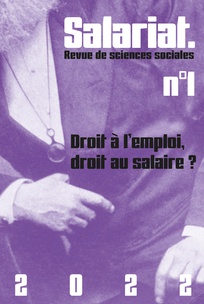La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une série d’arrêts en matière de relations collectives et individuelles du travail. Tour d’horizon des principaux arrêts :
Licenciement
Harcèlement moral : Licenciement pour faute grave d’un salarié qui n’est pas le supérieur hiérarchique direct de la victime
Le comportement harcelant à l’égard d’un employé justifie la faute grave, même s’il est commis par un salarié qui n’est pas le supérieur hiérarchique de ce dernier. C’est ainsi que juge la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 juin 2023.
Pour rappel : Selon l’article L1152-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En l’espèce, une salariée est engagée en qualité d'hôtesse de caisse, puis promue au poste de manager de caisses. Presque vingt ans après, elle a été mise à pied à titre conservatoire et finalement licenciée pour faute grave pour harcèlement moral.
La salariée en question a saisi les juges prud’homaux pour contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts. Elle soutient qu'elle n'exerçait aucune responsabilité hiérarchique sur l’employée qui se disait victime de ses agissements fautifs, celle dernière travaillant en parapharmacie. La Cour d’appel la déboute néanmoins de sa demande, en retenant l’existence d’une faute grave. Elle juge que la salariée a profité de sa position de manager pour harceler l’employée, sur fond de rivalité amoureuse, « en lui faisant état, à plusieurs reprises, de sa capacité de nuisance ».
La Cour de cassation s’aligne à la position des juges du fond. Elle considère que ces faits sont « incompatibles avec les responsabilités confiées à la salariée ». Ils rendaient donc « impossible son maintien dans l’entreprise », et cela, peu importe l’absence du lien hiérarchique direct.
Cass., Soc., 28 juin 2023, Pourvoi n° 22-12.777
Statut protecteur contre le licenciement d’un délégué syndical : la démission d’un délégué syndical prend effet à la date de l’information de l’employeur
C’est à la date à laquelle l’employeur est informé de la démission d’un délégué syndical que la fin du mandat de ce dernier prend effet. C’est ainsi que se prononce la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 juin 2023.
Pour rappel : Selon l’article L2411-3 du Code du travail : « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ».
En l’espèce, une salariée a été engagée en qualité de conducteur receveur, statut ouvrier, et désignée déléguée syndicale le 3 décembre 2015. Le 21 janvier 2016, elle a informé le syndicat de sa démission et ce dernier avise l’employeur de cette démission le 1er février 2016. Le 28 janvier, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licenciée pour faute grave le 4 mars 2016.
La salariée saisit les juges prud’homaux pour contester le bien-fondé de son licenciement intervenu en violation du statut protecteur, en lien avec le mandat syndical. La Cour d’appel donne droit à sa demande, en retenant que la salariée bénéficiait du statut protecteur jusqu'au 1er février 2016, date à laquelle l'information a été portée à la connaissance de l'employeur. L’employeur se pourvoit ainsi en cassation.
La Cour de cassation s’aligne à la position des juges du fond. La Cour rappelle tout d’abord qu’un délégué syndical « peut renoncer à son mandat en informant l'organisation syndicale qui l'a désigné de sa renonciation ». Elle confirme ensuite que « la démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet, à l'égard de l'employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance », pour en déduire, à présent, que « la salariée bénéficiait du statut protecteur jusqu'au 1er février 2016 ».
Cass.,Soc.,14 juin 2023, Pourvoi n°21-18.599
Dénonciation des faits de nature à caractériser un crime ou un délit : la Cour de cassation précise les conditions de protection contre le licenciement
La nullité du licenciement d’un salarié ayant dénoncé des faits, ne peut être prononcée que si ces faits sont susceptibles de caractériser un crime ou un délit. C’est ce qu’a retenu la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1er juin 2023.
Pour rappel :
Selon l’article L1132-3-3 du Code du travail : « Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
Ainsi, l’article L1121-2 du Code du travail précise que : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ».
En l’espèce, un salarié a été embauché en qualité de directeur d’exploitation. Par un courriel envoyé au président de son entreprise, il dénonce la légalité ou la régularité de la procédure de mise en place d'une carte de fidélité. Précisément, il estime que cette opération allait supprimer du chiffre d'affaires. Un an après l’envoi de ce courriel, le salarié en question a été licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle. Dans la lettre de licenciement, il lui est reproché que la dénonciation qu’il a faite, était un stratagème sous forme de menace et de chantage pour obtenir une rupture conventionnelle.
Le salarié saisit les juges prud’homaux pour contester son licenciement et demander des diverses sommes à titre de dommages et intérêts. La Cour d’appel fait droit à sa demande en relevant que le licenciement du salarié était consécutif, au moins pour partie, à une dénonciation d'un fait pouvant recevoir une qualification pénale. Elle en déduit alors que ce licenciement était nul. L’employeur se pourvoit ainsi en cassation.
La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel. Elle rappelle tout d’abord « qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté, de bonne foi, des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou pour avoir signalé une alerte ». Selon la Cour, les juges d’appel ne se sont pas prononcés sur le caractère des faits dénoncés par le salarié, ceux-ci étant susceptibles de constituer un délit ou un crime. Elle renvoie ainsi l’affaire devant la Cour d’appel.
Cass., Soc., 1er juin 2023, Pourvoi n° 22-11.310
Elections professionnelles : un salarié ne peut pas être licencié pour avoir préalablement demandé leur organisation
Dans un arrêt rendu le 28 juin 2023, la Cour de cassation apporte des précisions concernant la preuve en matière de discrimination syndicale. Selon elle, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre le licenciement d’un salarié, jugé sans cause réelle et sérieuse, et la demande préalable de ce dernier d’organiser des élections professionnelles au sein de l’entreprise.
En l’espèce, un salarié, embauché en qualité de serveur, a demandé l'organisation d'élections professionnelles en octobre 2015. Presque un mois après, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire, et a été finalement licencié pour faute grave quelques jours plus tard.
Le salarié a saisi les juges prud’homaux aux fins d'annulation du licenciement pour discrimination syndicale, de réintégration et de paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités. Précisément, il faisait valoir que l'employeur avait engagé une procédure de licenciement à son encontre le jour même de la réception du courrier par lequel il sollicitait l'organisation d'élections professionnelles.
La Cour d’appel l’a débouté de sa demande, en retenant que celui-ci « ne présente dans ses conclusions aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ». Conséquemment, le salarié se pourvoir en Cassation.
La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel. Elle rappelle tout d’abord que, « lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l'employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à la demande antérieure du salarié d'organiser des élections professionnelles au sein de l'entreprise ». Elle constate, qu’en l’espèce, « le licenciement prononcé n'était pas justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la demande du salarié d'organiser les élections professionnelles et le licenciement prononcé ».
Cass., Soc., 28 juin 2023, Pourvoi n° 22-11.699
Acteurs et relations collectives
Seul un accord d’entreprise peut mettre en place des représentants de proximité
Pour la première fois, la Cour de cassation précise le niveau à retenir pour la mise en place des représentants de proximité. Dans un arrêt rendu le 1er juin 2023, elle relève, selon une interprétation littérale des articles L2313-2, L2313-7 et L2232-12 du Code du travail, que seul un accord conclu au niveau de l’entreprise déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts peut instituer des représentants de proximité.
Pour rappel :
Selon l’article L2313-2 du Code du travail : « Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ».
L’article L2313-7 du Code du travail précise que :
« L'accord d'entreprise défini à l'article L2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.
L'accord définit également :
1° Le nombre de représentants de proximité ;
2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
3° Les modalités de leur désignation ;
4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions.
Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ».
Enfin, suivant l’article L2232-12 du même Code :
« La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. […] ».
Dans le cas de l’espèce, des négociations avaient été engagées au plan national entre un groupe ferroviaire et les organisations nationales représentatives, en vue de la conclusion d'un accord collectif portant à la fois sur la détermination des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques (CSE) et sur la mise en place de représentants de proximité. Faute d'accord, la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts a été réalisée par décision unilatérale de l’employeur. Saisis par voie d’un recours contre cette décision, la DIRECCTE, puis le tribunal d’instance, la valident. Parmi les 33 établissements distincts déterminés, figurait l’établissement « Gare et connexions », au sein duquel un accord d’établissement a été négocié qui fixait la mise en place de 25 représentants de proximité.
Une fédération syndicale non signataire de ce dernier accord a saisi le tribunal de grande instance en annulation des désignations des représentants de proximité, en invoquant que seul l'accord d'entreprise déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts pourrait mettre en place des représentants de proximité et définir leur nombre et leurs attributions. La Cour d’appel la déboute de sa demande, en retenant qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne s'oppose à l’institution de représentants de proximité par accord d’établissement.
La Cour de cassation ne suit pas l’argumentation des juges d’appel. Tout en rappelant les dispositions du Code du travail pertinentes en la matière (susvisées), elle juge que les représentants de proximité « ne peuvent être mis en place que par l'accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ».
La Cour prend aussi soin de clarifier l’hypothèse de l’échec des négociations et de détermination ainsi du nombre et périmètre des établissements distincts par décision unilatérale de l'employeur, validée dans le cadre d’un recours devant l’administration. Pour la Cour, là encore, « un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 de ce code (du travail) peut prévoir pour l'ensemble de l'entreprise la mise en place de représentants de proximité rattachés aux différents comités sociaux et économiques d'établissement ».
Cass. soc., 1er juin 2023, pourvoi nº 22-13.303
Audition des salariés par l’expert du CSE : l'accord de l’employeur et des intéressés doit être préalablement recueilli
La Cour de cassation apporte des limites aux prérogatives de l’expert-comptable désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale d’une l’entreprise. Dans un arrêt rendu le 28 juin 2023, la Haute juridiction juge qu’aucune audition ou interrogation des salariés n’est possible sans accord préalable de l’employeur et des salariés concernés.
Pour rappel :
Selon l’article L2315-81-1 du Code du travail : « A compter de la désignation de l'expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l'employeur un cahier des charges. L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ».
Les articles L2315-82 et L2315-83 définissent les pouvoirs d’investigation de l’expert-comptable. Ainsi, selon l’article L2315-82 du Code du travail : « Les experts ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission ». L’article L2315-83 du même code dispose que : « L'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission ».
En l’espèce, le comité social et économique (CSE) désigne un expert (une société d’expertise) pour l’assister lors des consultations annuelles sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Quelques jours après sa désignation, l'expert a notifié à l’entreprise sa lettre de mission. Concrètement, il envisageait de mener des entretiens avec vingt-cinq salariés, d’une durée d’une heure et demie chacun, ce qui représenterait un total de cinq entretiens sur cinq à six jours.
L’entreprise saisit le tribunal judiciaire aux fins de réduire le taux journalier et le coût prévisionnel de l'expertise ainsi que la durée de celle-ci. De sa part, l’expert demande qu’il soit fait injonction à l’employeur de lui permettre de conduire lesdits entretiens. Le tribunal judiciaire rejette la demande de l’expert. Il constate que l’employeur s'était opposé à ces entretiens, de sorte que le nombre de jours prévus pour l'expertise devait être réduit.
La Cour de cassation s’aligne à la position du tribunal. Elle rappelle tout d’abord les missions de l’expert, telles que prévues par les textes. Or, pour la Cour de cassation, ces textes n’autorisent pas l’expert à auditionner les intéressés sans leur accord, tout comme sans celui de l’employeur. Par conséquent, en l’absence de cet accord, ou, en l’occurrence, en cas d’opposition de l’employeur, cette audition n’est pas possible : « Il résulte de ces dispositions que l'expert-comptable, désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés ».
Cass., Soc., 28 juin 2023, Pourvoi n° 22-10.293
Conditions et organisation du travail
Entretien professionnel et entretien d’évaluation : leur organisation à la même date est possible
Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2023, la Cour de cassation reconnaît la possibilité d’organiser l’entretien professionnel et l’entretien annuel évaluation à la même date. Elle apporte ainsi une souplesse dans les règles régissant l’organisation de ces entretiens.
Pour rappel :
Selon l’article L.6315 du Code du travail : « A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle […] ».
Puis, les articles L.1222-1 à L.1222-5 du Code du travail encadrent l’évaluation du salarié, notamment :
Selon l’article L.1222-2 : « Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes. Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations. »
Suivant l’article L.1222-3 : « Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard. Les résultats obtenus sont confidentiels. Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie ».
En l’espèce, les salariés d’une entreprise saisissent les premiers juges pour contester la tenue, au même jour, de leur entretien professionnel et de leur entretien annuel d'évaluation. La Cour d’appel les déboute de leur demande en retenant que les dispositions légales n'imposent pas la tenue de ces entretiens à des dates différentes. Les salariés se pourvoient ainsi en cassation.
La Cour de cassation approuve le raisonnement des premiers juges. Tout en rappelant les dispositions de l’article L.6315 du Code du travail, la Cour considère que celui-ci « ne s'oppose pas à la tenue à la même date de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées ».
Cass., Soc., 5 juill. 2023, pourvoi nº 21-24.122.
L’interdiction au recours du travail de nuit ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre
Le 21 juin 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle affirme que l’interdiction au recours au travail de nuit ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre.
Dans les faits, un accord sur le travail de nuit a été signé entre la CFE-CGC, la CFDT et les sociétés de l’UES Monoprix le 11 décembre 2019. Le 7 février 2020, la CGT a saisi la juridiction civile afin de faire interdire l’application de cet accord et celle-ci prononce l’annulation de la convention ainsi que l’interdiction de recourir au travail de nuit sous peine d’astreinte.
Les sociétés de l’UES Monoprix décident de faire appel de ce jugement, débouchant sur une question prioritaire de constitutionnalité, visant à se demander si l’interprétation de la Cour de cassation de l’article L3122-1 en une interdiction absolue du recours au travail de nuit porte atteinte à la liberté d’entreprendre, prévue par la Constitution.
Pour rappel, l'article L3122-1 du Code du travail :
« Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ».
Voici la question prioritaire de constitutionnalité qui était posée aux juges :
« La jurisprudence constante depuis 2014 de la chambre criminelle et de la chambre sociale de la Cour de cassation, retenant une interprétation de l'article L. 3122-1 (ancien article L. 3122-32) du code du travail, qui interdit de facto le recours au travail de nuit aux entreprises du secteur de la distribution et du commerce alimentaire s'agissant de l'ouverture au public de nuit, est-elle conforme à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».
La Chambre sociale déclare la QPC irrecevable au motif que l’article L3122-1 a été déclaré constitutionnel en 2014 par le Conseil Constitutionnel[1]et la jurisprudence de la Cour de cassation n’a jamais modifié les « limitations encadrant le recours au travail de nuit ». Ainsi, l’interprétation n’ayant pas changé depuis, il est inutile de remettre en cause son caractère constitutionnel, et ce même pour la liberté d’entreprendre.
Cass. soc., 21 juin 2023, pourvoi nº 23-40.007